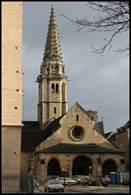|
DIJON |
||||
|
On
ne sait que peu de chose sur les origines chrétiennes de Dijon, mais la vie
religieuse est inséparable du culte de saint Bénigne. Disciple de saint
Polycarpe de Smyrne, il est le premier apôtre de la Bourgogne et serait mort
martyr à |
||||
|
Dijon,
alors petite localité du pays des Lingons. La
ville de Dijon dépendait du diocèse de Langres et, au début du Ve siècle, la
décision des évêques de Langres de venir y établir leur résidence a beaucoup
contribué au développement. Grégoire de Langres aurait ordonné la translation
des reliques de saint Bénigne. Près
du palais des évêques dans l'ancien castrum romain, fut édifiée l'église
Saint-Étienne qui leur servit de cathédrale. |
||||
|
De
l'autre côté du castrum, à l’ouest, les évêques firent construire au Ve
siècle leur chapelle sépulcrale. Cette
chapelle devint au Moyen Age l'église Saint-Jean. C'est vers
525 que fut fondée l'importante abbaye Saint-Bénigne,
sur le tombeau du saint. Soumis vers 865 à la règle bénédictine, ce monastère
fut rattaché à Cluny au début du XIe siècle. A la basilique romane édifiée de
1002 à 1018 par Guillaume de Volpiano succéda aux XIIIe-
XIVe s. l'église qui est devenue la
cathédrale Saint- Bénigne. En |
||||
|
Dijon
comptait à la fin du XIIe s. sept églises paroissiales : ·
Au
centre de la ville, l'église Saint-Médard, désaffectée en 1571 puis démolie en
1680. ·
A
l'ouest, Saint-Jean et Saint-Philibert
·
Au
sud, Saint-Pierre, aujourd'hui disparue
et remplacée par une église néo-gothique du XIXe. ·
A
l’est, Saint-Michel, ancienne chapelle du
cimetière des chanoines de Saint- Étienne ·
au
Nord deux églises, Notre-Dame et Saint- Nicolas, cette dernière
aujourd'hui disparue. |
||||
|
L'église Saint- Étienne étant devenue abbatiale après le retour des
évêques à Langres en 1016. Lorsque
les ducs de Bourgogne vinrent y installer leur cour fastueuse, Dijon allait
connaître son apogée monumentale, aux XIVe et XVe siècle |
||||
|
Plusieurs
communautés religieuses s'y établirent alors: Templiers, Cordeliers, etc. Un
magnifique édifice religieux devait surtout conserver le souvenir de cette
grande époque : la Chartreuse de Champmol, dévastée
en 1793. |
||||
|
Du
XVe s., signalons, dans l'arrière-cour de l’ancien hospice fondé au XIIIe
pour l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, la chapelle Sainte- Croix de Jérusalem fondée en 1454 et, depuis
1938, Musée des Hospices. |
||||
|
Dijon
ne souffrit pas trop des guerres de Religion, la ville s'étant d'emblée
prononcée pour le catholicisme. Le XVIIe s., période
de relatif effacement local, vit néanmoins la construction de nombreux
édifices religieux parmi lesquels il convient de citer la chapelle des Carmélites et son élégante façade, la chapelle du collège Godran autrefois tenu par les Jésuites, aujourd'hui
Bibliothèque municipale et la chapelle
du couvent des Bernardines devenu par la suite l'hôpital Sainte-Anne. |
||||
|
C’est
en 1731 que Dijon devint un évêché. La session des États de Bourgogne était
le grand événement de la vie locale et c'est pour les élus bourguignons qu'on
commença à construire, en 1740, dans le palais des Ducs, la chapelle des Élus. La
Révolution a laissé des traces à Dijon : outre la chartreuse de Champmol, qu'elle détruisit, elle s'attaqua également à
la Sainte-Chapelle qu’avait construit le duc Hugues III à la fin du XIe
siècle. Le
XXe siècle a vu la construction de nouveaux édifices religieux tels que l’église
Saint Joseph, l’église Saint Paul, le sanctuaire du Sacré-Cœur, l'église Saint Jean Bosco et plus récemment l’église Sainte Bernadette. |
||||
|
|
||||
|
|
||||